Au cœur des ténèbres (Heart of Darkness) et Apocalypse Now.
Au cœur des ténèbres (Heart of Darkness) et Apocalypse Now.
En matière d’adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires, s’il est bien un fait régulièrement avéré, c’est que l’adaptation filmique fait parfois complètement oublier l’œuvre originale alors que celle-ci ne manque pourtant pas de mérites.
Qui, par exemple, se rappelle que Les Sentiers de la perdition (Road to Perdition réalisé en 2002 par Sam Mendes avec un casting qui fait rêver : Paul Newman, Tom Hanks, Jude Law et Daniel Craig entre autres…) est avant tout une bande-dessinée ? Ecrite par Max Allan Collins (aussi connu pour plusieurs novélisations : Waterworld, Il faut sauver le soldat Ryan, Windtrackers…), ses trois tomes sont sortis 1998 (Road to Perdition), 2004 (On the Road to Perdition) et 2011 (Return to Perdition). Mais le film de Mendes, avec son casting prestigieux et ses nombreuses récompenses (Saturn et BAFTA Awards notamment) s’est imposé et lorsqu’on parle des Sentiers de la perdition, on a d’abord en tête le film avant le comic.
Un autre exemple, plus récent : il est probable que seuls les amateurs de polars (bien noirs) connaissent Dennis Lehane. Cet écrivain américain a commencé à écrire dans les années 90 et sa plume a été rapidement remarquée par les cinéastes. Ainsi, Clint Eastwood adaptera Mystic River en 2003 (roman éponyme publié en 2001), Ben Affleck Gone Baby Gone en 2007 (roman éponyme publié en 1998) et Martin Scorsese Shutter Island en 2010 (roman publié en 2003). Pourtant, lorsqu’on cite Shutter Island, on fait souvent davantage référence à Leonardo DiCaprio qu’au livre de Lehane. Et si c’est peut-être moins vrai pour les deux autres romans, il n’en reste pas moins que Mystic River et Gone Baby Gone sont (malheureusement ?) connus avant tout pour être des films.
Les films font donc parfois de l’ombre aux livres, même si, en tant qu’adaptations, ils leur doivent d’exister. Certains films vont même jusqu’à éclipser quasi-totalement le roman : le livre dont nous allons parler maintenant peut en témoigner. Il s’agit d’Au cœur des ténèbres (Heart of Darkness) de Joseph Conrad. Mais tout d’abord, un point sur l’auteur.
Joseph Conrad
Il n’est pas né Joseph Conrad mais (attention) Teodor Józef Konrad Korzeniowski. Il est polonais d’origine mais changera de nom en même temps que de nationalité en 1886. A l’âge de 29 ans, il deviendra britannique. Ses parents sont des nobles qui pâtiront cruellement de l’insurrection polonaise des années 1861-64 : en effet, en 1861, son père est envoyé en exil au nord de la Russie, puis en Ukraine. Sa famille le suit. Les conditions de vies sont épouvantables et auront raison des parents de Joseph. Sa mère meurt de la tuberculose en 1865 et son père, qui rentrera d’exil en 1868, rendra l’âme l’année suivante après une grave maladie.
En 1869, Conrad a alors onze ans et est orphelin. Il est élevé par son oncle maternel, Tadeusz Bobrowski. En 1974, il entame une carrière de marin, qui se poursuivra durant de nombreuses années et lui inspirera nombre de ses intrigues.
Toutefois, il faudra attendre la fin de sa carrière maritime pour qu’il entame sa carrière littéraire. En 1895 paraît La Folie Almayer (Almayer’s Folly : a Story of an Eastern River ; adapté au cinéma en 2011 par Chantal Akerman sous le même titre) qui inaugure une trilogie (la Trilogie malaise) qui comptera aussi Un paria des îles (An Outcast of the Islands, en 1896) et La Rescousse (The Rescue, 1920). S’en suivront de nombreux romans et nouvelles, publiés avec une étonnante régularité. Parmi ceux-ci on pourra retenir notamment Le Nègre du Narcisse (The Nigger of the Narcissus, 1897) qui est connu pour être le premier roman maritime de Conrad et est en partie autobiographique. Cette courte œuvre raconte l’histoire du Narcisse, un voilier qui quitte le port de Bombay et doit rejoindre l’Angleterre. A son bord, un équipage pour le moins hétéroclite dont un Noir nommé James Wait, qui deviendra rapidement le canalisateur des tensions à bord. Il s’agit d’un véritable huis-clos en haute mer dont la lecture marque durablement le lecteur.
On peut également citer Lord Jim, publié en 1900. Cette histoire, qui fait indéniablement partie des chefs d’œuvres de Joseph Conrad, narre le destin tragique de Jim, un lieutenant embarqué comme second sur un navire censé convoyer un groupe de pèlerins à travers la Mer Rouge. Mais un évènement, assez récurrent dans les romans de Conrad, survient, qui mène à la catastrophe : une tempête malmène le navire. La violence de la mer est telle que Jim, apeuré par un naufrage qui lui semble inévitable, quitte avec lâcheté son bateau, laissant tous ses passagers à leur triste sort. Hanté par son acte et en quête de rédemption, il voyage vers la Malaisie et, pour se racheter, participe à une révolution populaire qui met à bas un dictateur local. Le style de Conrad est magnifique : mariant dialogues et monologues au sein d’un récit à tiroirs à la narration complexe, l’auteur parvient à brosser le portrait d’un héros torturé par son passé et déchiré par de cruelles contradictions.
On peut également parler de L’Agent Secret (The Secret Agent, 1907) qui sera adapté en 1936 par Alfred Hitchcock sous le titre Sabotage. Conrad abandonne ici ses intrigues maritimes et livre au lecteur un roman politique se déroulant dans le cœur de Londres. Il y raconte la tentative d’attentat perpétré par des anarchistes anglais, qui doivent poser une bombe dans l’Observatoire de Greenwich. Conrad y déploie des merveilles d’imagination, qualité dont il ne manque pas et dont il fera montre dans tous ses romans. Les personnages sont admirablement décrits, tout comme la vie londonienne dont l’auteur ne montre pourtant que les aspects les plus sordides.
Enfin, il est un titre à retenir, qui figure également parmi les chefs d’œuvre de l’auteur, un livre dont nous allons maintenant parler : il s’agit d’Au cœur des ténèbres (Heart of Darkness, 1899).
Le livre
Originellement publié en feuilleton dans le Blackwood’s Magazine, ce roman, qui ressemble plutôt à une longue nouvelle, à une novella, fut par la suite republié au sein d’un recueil de trois récits intitulé Youth : A Narrative, and Two Others Stories (Jeunesse, 1902).
Au cœur des ténèbres est le récit halluciné d’un voyage effectué par Charles Marlow, un marin britannique embauché par une compagnie belge afin de rétablir le contact et le lien commercial avec le directeur d’un comptoir d’ivoire, un directeur dont on est sans nouvelles : Kurtz. Marlow quitte donc la mer sur laquelle il a toujours navigué et entreprend de remonter le cours du fleuve Congo (le fleuve traversait, à l’époque de la rédaction comme de l’intrigue du roman, l’Etat indépendant du Congo, qui était propriété du roi Léopold II de Belgique) afin de découvrir cet homme dont tout le monde s’accorde à dire qu’il est exceptionnel, visionnaire, sans que Marlow sache toutefois vraiment pourquoi. Son périple l’emmènera au cœur du continent africain, dans une nature inculte de forêts primaires, à travers des lieux sauvages que l’homme n’a pas ou peu foulés et dont l’atmosphère étouffante et souvent hostile l’amènera à reconsidérer en profondeur sa place dans le monde, la valeur de la vie et le sens de son existence.
Pour la rédaction de son œuvre, Conrad a trouvé sa matière à plusieurs endroits, bien distincts. Il s’est tout d’abord inspiré du récit que le célèbre explorateur britannique Henry Stanley a fait de son voyage à la recherche d’Eduard Schnitzer, un autre célèbre explorateur, allemand cette fois, gouverneur de la province égyptienne d’Equatoria et dont l’Europe s’inquiétait du sort puisque depuis 1883, date à laquelle une révolte éclata qui obligea Schnitzer à se retrancher dans sa forteresse, il envoyait des messages de secours au vieux continent. Stanley envisagea de récupérer Schnitzer en remontant le fleuve Congo, tout en sachant qu’il traverserait des zones extrêmement dangereuses. De fait, il perdit les deux tiers de ses hommes et, au final, ne parvint jamais à ramener Schnitzer en Europe.
Le récit que fit Stanley de ce malheureux périple parut en 1890 à Paris. Il est intitulé In Darkest Africa (Dans les ténèbres de l’Afrique).
Mais Conrad a également pu trouver une partie de la matière de sa novella dans une nouvelle de Rudyard Kipling intitulée L’Homme qui voulut être roi, parue en 1888. La nouvelle de Kipling raconte l’histoire de la tentative folle de deux hommes pour transcender leur condition et devenir les rois d’un pays qui n’a plus connu d’occidental depuis Alexandre le Grand. Jouant sur leur apparente immortalité (l’un des deux hommes, Daniel Dravot, reçoit en pleine poitrine une flèche qui vient en fait se ficher dans sa cartouchière, dissimulée sous sa chemise ; mais les indigènes, ignorant ce fait, le croient tout à fait immortel) ils profitent de leur supériorité pour asseoir leur pouvoir et se faire sacrer rois.
C’est effectivement à peu de choses près le destin du mystérieux Kurtz. A l’issue de son périple, Marlow, après avoir longtemps couru derrière un mythe qui semblait constamment glisser entre ses mains, découvrira un homme qui n’a plus rien du directeur classique d’un comptoir commercial : complètement déifié par les indigènes, Kurtz est devenu une espèce de demi-dieu, qui, par un art consommé de la manipulation mentale, sait se faire obéir au doigt et à l’œil par ses esclaves.
Mais Joseph Conrad, et c’est certainement là le plus important ou du moins le plus intéressant, s’est également inspiré de sa propre vie pour la rédaction d’Au cœur des ténèbres. Engagé en 1890 par la Société du Haut-Congo, il devient capitaine du steamer (navire à vapeur) Le Roi des Belges. Bien que son contrat stipule qu’il est engagé pour trois ans, Conrad devra être rapidement rapatrié en Europe pour cause de dysenterie. Il n’aura eu le temps d’effectuer sur le fleuve Congo qu’un aller-retour entre Stanley-Pool (aujourd’hui Pool Malebo, il s’agit d’un lac) et Stanleyville (aujourd’hui Kisangani) mais, on imagine, se sera parfaitement imprégné de la lourde atmosphère des lieux.
Il est donc assez probable que les impressions de Marlow lorsqu’il remonte le fleuve à bord, lui aussi, d’un vapeur, soient directement inspirées de celles de Conrad lorsqu’il joignit Stanleyville. L’auteur, qui a posé ses yeux sur ces berges sauvages, qui a navigué sur cette eau brune et épaisse regorgeant de dangers, qui a entendu les troublants murmures de la forêt, cet homme a transféré à son héros une partie de son vécu intime, il a créé un double romanesque de lui-même. On peut donc lire Au cœur des ténèbres comme une histoire en partie autobiographique et cela renforce indéniablement la fascination que l’œuvre exerce sur le lecteur.
Mais revenons à l’histoire : Marlow est donc engagé par une société commerciale belge pour retrouver un certain Kurtz, un homme que le lecteur découvrira en même temps que Marlow, qui narre d’ailleurs sa propre histoire. Son périple tout au long du fleuve est ponctué par une série de rencontres : des hommes ayant tous plus ou moins oublié ce que peut être la civilisation, des hommes dont la vie a été durement marquée par les privations, le climat, les maladies, qui ont perdu leurs illusions et semblent rester sans raison au cœur de cette Afrique qui a fini par les posséder.
Puis vient la rencontre avec celui que l’on attend durant toute cette novella, le fameux Kurtz. Son image s’est immiscée comme un lent poison dans l’esprit de Marlow. Au départ à peine esquissé, le portrait de Kurtz se précise au fur et à mesure des rencontres que fait Marlow. Ses interlocuteurs parlent de lui comme d’un homme « remarquable », « extraordinaire », un homme qui n’a pas son pareil mais reste tout à fait à l’écart, volontairement, de la civilisation. Sa tyrannie, qui est folie, semble l’avoir coupé du monde pour de bon.
Nous ne dévoilerons évidemment pas ici tous les aspects du roman. Conrad parvient admirablement à marier le genre du roman d’aventures à la description psychologique inspirée, sa démarche semble avoir été de montrer au monde occidental ce qu’il a peu à peu oublié : la part sauvage de l’homme, qui sommeille au fond de la conscience de chacun et se réveille au contact d’une nature hostile, voire cruelle, qui change quiconque fait l’expérience de cette perte de repères. Mais il ne faut pas croire toutefois que cette perte de repères correspond à une perte de l’humanité dans l’homme : Marlow, et surtout Kurtz, redécouvre une vie qui s’est dégagée des considérations morales de l’homme civilisé mais qui n’est pas pour autant une vie déshumanisée. Les critères du jugement ont seulement changés, et avec eux, le rapport intime que l’homme entretient avec le monde et ses semblables. On pourrait, pour commenter cette démarche visant à retrouver une vie « naturelle », gouvernée par les seuls instincts, citer Samuel Johnson, qui disait : « Celui qui se fait bête se débarrasse de la douleur d’être un homme ». Kurtz, pourtant, semble évoluer en marge des deux et s’il n’est plus tout à fait l’homme auquel on peut penser, cet homme qu’est encore Marlow, aux réflexes conditionnés par l’éducation et la morale, il n’est pas non plus la bête dont parle Johnson. Pour son malheur, il ne peut l’être, étant né homme.
Nous espérons que ces quelques lignes auront donné envie au lecteur de découvrir ce court chef d’œuvre, si bien écrit et dont chaque ligne, en nous enfonçant davantage au cœur de la nature humaine et de l’Afrique des mythes et des légendes, amène à reconsidérer les acquis de la civilisation et jette une lumière parfois intolérable sur cette apparente sensation d’ultime liberté, qui semble émerger du chaos.
Francis Ford Coppola
Au cœur des ténèbres a inspiré F. F. Coppola de la plus belle des manières : il lui a permis de réaliser un chef d’œuvre de noirceur à la portée critique indéniable. Encore aujourd’hui, il figure parmi les films les plus connus du grand réalisateur américain, à côté, notamment, de la trilogie du Parrain.
Avant de nous pencher sur Apocalypse Now, quelques mots sur son réalisateur et notamment sur sa carrière avant ce film.
Le parcours de F. F. Coppola, s’il fut ponctué de chefs d’œuvres qui devinrent par la suite des films cultes, a néanmoins connu des hauts et des bas. Il débute dans les années 60, sous la houlette de Roger Corman, grande figure d’Hollywood et réalisateur réputé de films de série B à qui l’on doit également d’avoir découvert des réalisateurs de grand talent comme Martin Scorsese, Ron Howard ou encore Jonathan Demme.
Sa première œuvre notable en tant que réalisateur est Dementia 13 (1963) pour lequel il a obtenu de Corman l’autorisation de tourner avec les mêmes décors, la même équipe technique et les mêmes acteurs que pour The Young Racers (1963), un film réalisé par Corman lui-même et pour lequel Coppola était réalisateur de seconde équipe.
Après l’obtention de son diplôme de fin d’études à l’UCLA (University of California, Los Angeles) Film School (où il a entretemps rencontré un certain Jim Morrison), il se voit offrir par Jack Warner (l’un des fondateurs de la mythique société de production Warner Bros.) l’adaptation cinématographique de la comédie musicale Finian’s Rainbow (créée en 1947). La chanteuse Petula Clark et l’incontournable Fred Astaire sont de la partie. Rien de moins. Si le film est une demi-réussite, il a toutefois le mérite de permettre à Clark de lancer sa carrière d’actrice aux Etats-Unis.
C’est sur le tournage de Finian’s Rainbow (en français La Vallée du bonheur, 1968) qu’il rencontre un homme qui marquera lui aussi de son empreinte l’histoire du cinéma, mais ce, dans un tout autre registre : George Lucas. Alors jeune stagiaire (eh oui, le père de Star Wars a débuté comme tout le monde, au bas de l’échelle), Lucas développe parallèlement la réalisation de son film de fin d’étude : THX 1138 : 4EB. Le court métrage sera récompensé par un prix et Coppola, qui a entretemps sympathisé avec Lucas et a créé avec lui en 1969 la société de production American Zoetrope, encourage ce dernier à réaliser une version longue de son film qu’il s’engage à produire.
Malheureusement, THX 1138 (1971) est un désastre financier et Coppola se retrouve obligé d’accepter un film de commande. Lui qui rêvait d’être indépendant… Le film en question est tiré d’un roman de Mario Puzo ayant pour titre… Le Parrain (publié en 1969). Produit par Robert Evans (également producteur de Rosemary’s Baby ou de Chinatown), le film est dès sa sortie (1972) un succès incroyable est permet d’amortir confortablement un investissement de départ pourtant important (6.500.000 dollars – en comparaison, Dementia 13 n’avait bénéficié que de 30.000 dollars). Au-delà des qualités évidentes de mise en scène et de scénario, le film doit également son succès à la présence d’une pléiade d’acteurs de grand talent, dont certains déjà connus à l’époque : Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan… sans oublier Diane Keaton.
L’année précédant la réalisation du Parrain, Coppola avait été pour la première fois récompensé aux Oscars mais en tant que scénariste : pour le film de Franklin J. Schaffner, Patton (1970), film biographique sur le général du même nom qui reçut, en plus de l’Oscar du meilleur scénario, 6 autres Oscars dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour George C. Scott.
Le Parrain obtiendra quant à lui 3 Oscars en 1972 : celui de meilleur film, de meilleur scénario adapté et de meilleur acteur pour Marlon Brando, qui refusera le prix pour protester contre la manière dont le cinéma américain traite les Indiens dans ses films. Pour l’occasion, il enverra à sa place à la cérémonie de remise des Oscars Sacheen Littlefeather, activiste pour la défense des droits civiques des Indiens. Cette dernière arrivera costumée de la tête au pied en Apache.
Deux ans après Le Parrain, Coppola tourne sa suite : Le Parrain – 2ème partie (1974). Marlon Brando, qui incarnait Vito Corleone, a cédé la place à son fils : Michael Corleone, joué par Al Pacino. Robert De Niro est également de la partie, Coppola l’ayant intégré au casting pour le rôle de Vito jeune. Le film remportera à nouveau l’Oscar du meilleur film et Coppola est enfin récompensé de son travail de réalisation car l’Académie des Oscars lui décerne également celui du meilleur réalisateur.
Son film suivant est Apocalypse Now.
Le film
On l’a dit, Apocalypse Now n’est pas ce que l’on pourrait appeler une adaptation fidèle du roman de Joseph Conrad. A vrai dire, Coppola n’a, d’une manière générale, gardé du film que la remontée du fleuve d’une équipe à la recherche d’un mystérieux individu qui semble échapper aux qualificatifs. La trame est donc conservée mais le contexte historique, quant à lui, diffère complètement.
Conrad avait placé son histoire en plein cœur du Congo belge, à la fin du 19ème siècle. Lorsque Coppola entreprend la réalisation de son film (en mars 1976), les Etats-Unis sortent à peine de la très meurtrière et très controversée guerre du Viêt Nam.
Ce nouveau contexte semble comme s’imposer de lui-même. On remarquera sur ce point que si Apocalypse Now est sorti en salles seulement 4 ans après la fin de la guerre, il n’est toutefois pas le premier film américain à avoir traité du conflit. En 1978, soit juste un an avant Apocalypse Now, sortait Voyage au bout de l’enfer (The Deer Hunter) de Michael Cimino, qui reste indéniablement le chef d’œuvre de ce dernier. Le film, illuminé par les présences magnétiques de Robert De Niro et de Christopher Walken (ce dernier obtiendra d’ailleurs pour cette performance l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 1979), traite, au-delà de l’aspect historique de la guerre du Viêt Nam, qui est très bien reproduit, des traumatismes, physiques comme psychologiques, subis par les soldats américains pendant et après les conflits (on pourra également voir sur ce point le très beau Birdy, d’Alan Parker, sorti en 1984, avec au casting Matthew Modine et Nicolas Cage).
Coppola décide donc de transposer son récit en plein cœur du conflit, remplace les marins du steamer de Marlow par une petite équipe de soldats. Toutefois, leur but est similaire à celui poursuivi par Marlow : si ce dernier, dans le roman de Conrad, part à la recherche d’un Kurtz qui donne de moins en moins signe de vie et semble comme avoir décidé de définitivement couper les ponts avec la civilisation, les soldats américains, de leur côté, remontent un fleuve afin de trouver un colonel également nommé Kurtz, qui semble avoir perdu la raison et opère maintenant en toute liberté, sans tenir compte des ordres de sa hiérarchie.
Le film débute à Saigon, au Viêt Nam, où l’on rencontre le capitaine Benjamin Willard (brillamment interprété par Martin Sheen) qui tente de noyer son désespoir dans la boisson en attendant qu’on daigne lui confier une quelconque mission. Elle finit par arriver et se révèle particulièrement périlleuse. De plus, elle est classée top-secret. En effet, Willard reçoit l’ordre par ses supérieurs de remonter la rivière Nung, en plein cœur de la jungle vietnamienne, de pousser son périple vers le territoire cambodgien (resté neutre) afin de retrouver le colonel des Forces Spéciales Walter Kurtz (Marlon Brando) et de le tuer afin de l’empêcher une bonne fois pour toutes de continuer ses sanguinaires massacres.
La tâche est rude mais de toute façon Willard n’a pas le choix. Il rejoint donc l’équipe d’un PBR (Patrol Boat River, il s’agit d’un petit bateau (moins de 10 mètres) massivement utilisé par la Navy durant la guerre du Viêt Nam et dont l’occupation principale était la recherche et le contrôle d’embarcations ennemies pour contrecarrer le trafic d’armes et le ravitaillement).
Celle-ci se compose d’individus pour le moins assez différents les uns des autres. Nous avons tout d’abord « Chief » (incarné par Albert Hall), le commandant du PBR qui est certainement celui parmi les soldats qui possède le plus de sang-froid. Bien qu’il soit relativement effacé, sa présence est palpable et lorsqu’il parle, on l’écoute. Il y a également « Chef » (Frederic Forrest qui a tourné plusieurs fois pour Coppola : dans Conversation secrète (The Conversation) en 1974, Coup de cœur (One from the Heart) en 1982 et Tucker (Tucker : The Man and His Dream) en 1988), un homme à la nervosité à fleur de peau qui finira par se droguer pour échapper à l’idée que la mort peut surgir à tout moment de la jungle.
Parmi cette équipée on trouve aussi Lance (Sam Bottoms), un jeune homme connu dans son pays pour ses exploits de surfer. Il semble être le soldat le moins concerné par la situation et finira progressivement par perdre la raison, aidé en cela par une consommation ininterrompue de psychotropes. Enfin nous avons le plus jeune de la bande, le très volubile « Mr Clean », probablement surnommé ainsi par qu’il se trouve être le préposé à la mitrailleuse Browning qui surmonte le PBR. Il est interprété par l’adolescent Laurence Fishburne (autrement connu pour son rôle de Morpheus dans la trilogue Matrix). Fishburne a dû mentir sur son âge pour intégrer le casting d’Apocalypse Now : alors que son personnage devait paraître avoir 17 ans, il réussit à se faire engager alors qu’il n’avait, en réalité, que 14 ans… Sa performance est impressionnante.
Voilà l’escouade qui partage avec la capitaine Willard les 10 mètres du bateau. Au fur et à mesure que tous s’enfoncent dans la jungle vietnamienne, les tensions grandissent : Willard ne peut leur avouer que sa mission consiste à tuer un colonel de l’armée américaine, réfugié au fin fond du Cambodge et qui semble avoir créé de toutes pièces, aidé en cela par sa force de manipulation mentale et la superstition des autochtones, un véritable culte autour de sa personne. De fait, les soldats ne peuvent que se plier aux ordres de Willard, qui tiendra pendant un long moment sa mission secrète, comme ses supérieurs lui ont demandé.
Mais le véritable facteur de tension entre les hommes est moins le fait de cette mission secrète que de l’éventualité de leur mort, qui peut arriver à tout moment. Apocalypse Now est moins un film de guerre qu’un film sur la guerre et ceux qui ne l’ont pas encore vu chercheront en vain les scènes de combat. Il y a bien sûr des moments de bravoure : l’attaque d’un avant-poste vietnamien par un escadron d’hélicoptères emmené par le kamikaze lieutenant-colonel Kilgore (Robert Duvall) avec, en fond sonore, la Chevauchée des Walkyries de Richard Wagner, une séquence devenue culte. On pourra également mentionner l’incident survenu alors que l’équipage du PRB surprend sur le fleuve une embarcation vietnamienne : le contrôle de routine, imposé par « Chef » à un autre membre du groupe, vire rapidement à l’affrontement verbal entre les deux hommes et un mouvement suspect d’une vietnamienne effraie complètement Mr Clean et Lance, qui mitraillent soudainement le bateau, dans un accès de panique, laissant seulement un agonisant qui sera bientôt achevé par Willard (un épisode qui pourra rappeler une des dernières scènes de la fin de Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick, sorti en 1987 et traitant lui aussi de la guerre du Viêt Nam).
Mais d’une manière générale, le combat dans Apocalypse Now est relayé au second plan. Selon moi, le sujet principal de ce film est l’attente, qui se décline d’ailleurs selon trois modes différents, se répondant les uns les autres. Il y a tout d’abord cette attente horrible tout au long du fleuve, que concerne chacun se retrouvant à naviguer sur celui-ci : le jeu des acteurs rend parfaitement cette atmosphère électrique dans laquelle baignent les craintes, fondées, des soldats, de se voir à chaque instant la cible des balles ennemies. C’est particulièrement le cas lorsque le PRB quitte la zone connue par les forces américaines et commence à s’enfoncer dans des territoires peu explorés, encore susceptibles de cacher toutes sortes de dangers (deux des membres manquent de peu de se faire dévorer par un tigre). Il faut donc bien ouvrir les yeux pour éviter de devoir les fermer pour toujours.
Ensuite nous avons une attente d’un autre ordre, qui concerne particulièrement le capitaine Willard : la rencontre avec Kurtz. Depuis le départ, le capitaine a recueilli des informations étonnantes provenant de sources diverses mais qui font toutes de Kurtz un personnage hors du commun. Un fait qui, sur ce point, rappelle bien le roman de Conrad. A mesure qu’il épluche le dossier de Kurtz, que lui a remis son état-major et qu’il a emporté avec lui sur le bateau, Willard est décontenancé par ce qu’il découvre : le colonel Kurtz semble avoir était un modèle de patriotisme et de bravoure, il a été récompensé par de nombreuses distinctions, ses états de service sont irréprochables… Qu’est-il donc arrivé pour qu’il décide subitement de quitter l’armée et de s’enterrer en pleine jungle cambodgienne ? Plus le film avance et plus cette question envahit l’esprit de Willard au point qu’il finit par ne plus tenir compte des dangers de sa mission et ne souhaite plus qu’une seule et unique chose : rencontrer, coûte que coûte, celui que les indigènes ont érigé en dieu.
Enfin, il est une troisième attente, beaucoup moins visible mais qu’il ne convient pas, à mon sens, de passer sous silence car elle sous-tend l’ensemble du film : l’attente de la fin de la guerre. Apocalypse Now est d’abord et avant tout un film qui dénonce la présence des troupes américaines au Viêt-Nam et les conditions de vie des soldats dont beaucoup se demandent pourquoi ils combattent et quand cette guerre finira. Plusieurs séquences du film montrent une armée davantage préoccupée par la possibilité de se distraire que par le sentiment profond et patriotique d’une guerre juste qu’il convient d’achever. Que peut-on penser du lieutenant-colonel Kilgore, dont l’obsession pour le surf ira jusqu’à mettre en péril la vie de ses soldats ? Alors que le village vietnamien flambe encore sous le napalm et que les balles n’ont pas fini de siffler dans l’air, il ordonne à deux de ses hommes d’aller tester les rouleaux qui déferlent devant lui, avant de vouloir aller les surfer lui-même. Que penser également de la grande parade organisée en pleine jungle (une scène particulièrement surréaliste) où les soldats assistent à un show, plus ou moins improvisé, de miss à moitié dénudées aux danses pour le moins aguicheuses ? La séquence est assez indescriptible. On retrouvera certaines de ces playmates dans un avant-poste américain abandonné où elles partageront, l’espace de quelques heures, les rêves et les peurs des soldats de l’équipage de Willard.
A cette attente fait immanquablement pendant le doute qui ronge les soldats américains, comme le rappelle bien Gaëtan Chaubert, dans l’article qu’il consacre à Apocalypse Now, sur le site de l’association Thucydide-Conception : « L'action du film se situe en 1969, après l'offensive du Têt de janvier 1968, c'est-à-dire à un moment où les Etats-Unis ne sont plus sûrs de pouvoir remporter militairement cette guerre ».
Apocalypse Now fait donc partie de ces films engagés contre la guerre du Vietnam, qui ont vu le jour dès les années 60 et parmi lesquels Gaëtan Chaubert range également le célèbre MASH, réalisé par Robert Altman et sorti en 1969.
Coppola invite donc son spectateur à une vision critique de son œuvre mais ne réalise pas pour autant un film qui ne serait que pur engagement politique de sa part. Si son propos porte bien sur les dérives d’une guerre illégitime, il fait aussi la part belle à l’introspection psychologique et, comme Conrad avant lui, questionne les notions de bien et de mal, de morale et d’immoralité.
Regarder Apocalypse Now, c’est accepter de perdre ses repères l’espace de quelques heures, c’est accepter d’accompagner Willard, Chef et les autres au cœur de cette jungle délétère qui semble comme dévoiler par moments aux yeux de l’homme la part de sauvagerie qui sommeille encore en lui. C’est un voyage difficile que celui de ces hommes engagés dans une guerre qui rapidement les dépasse, une guerre dont ils ne connaissent d’ailleurs pas tous les tenants et aboutissants. En cela, le destin des soldats de ce petit bateau, remontant les eaux glauques d’un fleuve qui peut à tout moment les engloutir, est à l’image du destin de nombreux autres, qui ont connu l’enfer de la guerre et de la remise en question de toutes les valeurs humaines.
Martin, de l'équipe Plumicule.




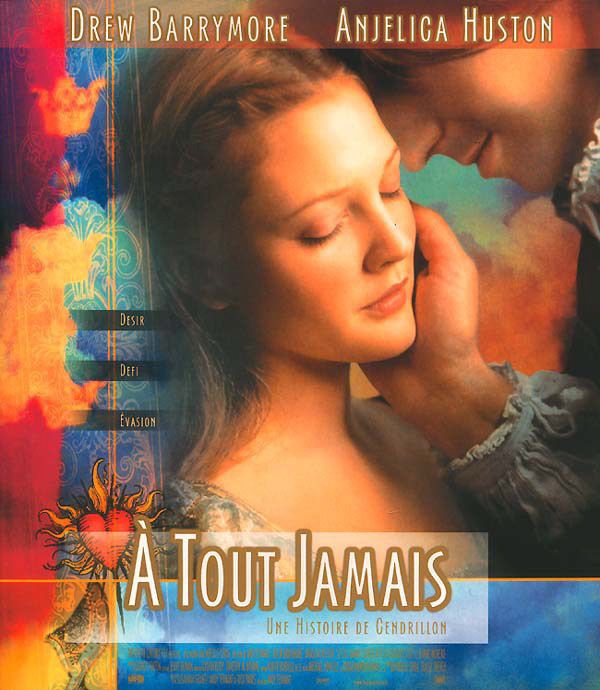









/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F1%2F1117337.jpg)